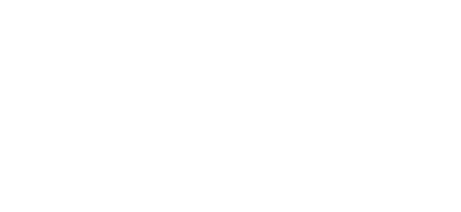La photographie permet de porter un regard plus aiguisé sur le monde qui nous entoure, et notamment lorsque nous dirigeons notre appareil photo sur des sujets souvent ignorés à cause de leur taille infime. Grâce à la photographie, il est possible de sublimer ce petit monde et d’en relever des détails autrement impossibles à percevoir. Les automatismes d’exposition et de mise au point et, plus récemment, l’avènement de la prise de vue numérique, ont rendu la photographie rapprochée et la macrophotographie accessible au plus grand nombre. Plus que jamais, il est facile de prendre de belles images de fleurs, d’insectes ou de votre collection de timbres ou de pièces de monnaie. Mais avant de vous plonger dans l’univers du tout-petit, attardez-vous sur les quelques particularités qui distinguent la “proxiphotographie” de la photographie “normale”.

Pour qu’on puisse qualifier une image de macrophotographie, les dimensions d’un sujet sur le film ou le capteur doivent être supérieures ou égales à ses dimensions réelles. Alors que la définition de la macrophotographie est non équivoque, la limite entre la photographie « normale » et la photographie rapprochée n’est pas si clairement dessinée. Certains s’appuient sur l’exposition pour définir la limite à partir de laquelle on entre dans le royaume de la photographie rapprochée : celle-ci commencerait alors là où l’augmentation du tirage optique nécessite une correction de l’exposition. La luminosité nominale d’un objectif est en effet uniquement respectée lorsque la bague de mise au point est réglée sur l’infini. Le déplacement des éléments optiques et/ou du fût de l’objectif provoque en fait une perte de luminosité plus ou moins importante.

Au départ, cette perte demeure négligeable, bien qu’elle augmente proportionnellement à l’extension du fut de l’objectif. Certains puristes estiment alors que la prise de vue rapprochée commence à un grandissement de 1/20, c’est-à-dire lorsque la réduction de l’intensité lumineuse est d’environ 10 %. Mais cette définition n’est guère satisfaisante. D’une part, il est impossible de compenser une telle différence d’exposition par le réglage manuel de l’ouverture du diaphragme et de la vitesse d’obturation et d’autre part, les appareils modernes la compensent automatiquement et il n’est donc pas nécessaire de se soucier d’une telle différence. Retenez simplement qu’une augmentation du rapport de reproduction engendre une augmentation du tirage mécanique et ainsi une perte plus ou moins importante de la lumière parvenant jusqu’à la surface du capteur. Pour compenser le manque de lumière à des taux de grandissement plus importants, vous pouvez augmenter le réglage de sensibilité ISO de votre appareil et/ou ajouter un ou plusieurs éclairages auxiliaires (flash, halogène ou LED).
La plupart des photographes considèrent que la photographique rapprochée commence là ou la distance minimale de votre objectif ne suffit plus pour restituer le sujet dans les dimensions souhaitées. Certains objectifs sont alors plus doués que d’autres. Pour ne citer que quelques exemples de la gamme Canon, les objectifs zoom grand-angle EF 17-40 mm L USM et EF 24-105 mm f/4 L IS USM permettent de restituer votre sujet à un quart de sa taille réelle à leur focale la plus longue alors que les objectifs standard EF 50 mm f/1, 4 USM et EF 50 mm f/1,8 II se contentent d’un rapport de reproduction presque deux fois moins important.
Cependant, sachez que la conception d’un objectif demeure assujettie aux contraintes imposées par les lois physiques, et ce, en dépit de l’utilisation des verres rares et/ou à surfaces asphériques dont bénéficient la plupart des objectifs contemporains. La correction optimale d’un objectif n’est réalisée qu‘à une seule distance de mise au point, située le plus souvent à mi-chemin entre l’infini et la distance de mise au point minimale. Plus vous éloignez un objectif des domaines d’utilisation pour lesquelles il a été optimisé, plus les différents défauts optiques se manifestent et plus ces derniers dégradent la qualité des images. Planéité de champ défaillante, aberrations sphériques gênantes ou distorsion augmentée, la plupart des défauts évoqués apparaissent surtout si vous photographiez un timbre, une pièce de monnaie, une carte postale ou un autre objet bidimensionnel. Si en revanche votre sujet s‘étend également dans la troisième dimension (fleur, insecte, etc.) et si vous le placez au centre de l’image, les parties périphériques se situent le plus souvent à l’extérieur de la plage de profondeur de champ et le flou du aux divers défauts optiques se mêle alors au flou naturel — la perte de qualité passe de ce fait souvent inaperçue.

De manière générale, la qualité optique aux distances plus proches est aussi tributaire de la construction optique. Plus la composition des éléments optiques est symétrique, plus l’objectif en question se prête à la photographie rapprochée. C’est pourquoi les objectifs de focale standard, bénéficiant le plus souvent d’une conception de type Gauss, rendent de précieux services aux distances de mise au point réduites. Certains objectifs trans-standard et téléobjectifs sont également à leur aise lorsqu’il s’agit de saisir des sujets proches alors que certains objectifs grand-angle sont à même de produire des images bien définies, grâce à des lentilles flottantes.
Le rapport de grandissement désigne la relation entre les dimensions réelles d’un sujet et celles réalisées sur le capteur. La plupart des objectifs macro courants sont à même de proposer des facteurs de 0,5 ou 1, c’est-à-dire un sujet qui mesure 1 cm fait 0,5 ou 1 cm sur le capteur. Pour atteindre des grandissements encore plus importants, vous pouvez choisir parmi les accessoires suivants : bague d’inversion, bague de couplage macro, bague allonge, soufflet macro, télé-convertisseur et/ou bonnette macro, le choix et vaste et adapté à des budgets plus ou moins serrés. Sachez aussi qu’il est possible d’adapter un objectif d’agrandisseur ou de dénicher sur le marché d’occasion un objectif spécialisé, conçu pour être utilisé avec un soufflet macro (Leitz Photar , Novoflex, Canon Macro, Minolta Micro Rokkor, Olympus Zuiko-Macro MB, etc.). Encore commercialisé et beaucoup plus facile à utiliser, l’astucieux et très performant Canon MP-E 65mm 1-5x Macro propose, quant à lui, des facteurs de grandissement qui varient entre 1 et 5 fois.

Les taux de grandissement cités plus haut se rapportent à un appareil dont la surface sensible, film ou capteur, est égale à 24 × 36 cm. Si vous adaptez un objectif “plein format” sur un appareil dont le capteur est de type APS-H (Canon 1D) ou APS-C/DX, il faut les multiplier par un facteur de 1,3, 1,5 ou 1,6. Les différents capteurs introduisent un recadrage plus ou moins prononcé : ainsi, plus les dimensions d’un capteur sont petites, plus un sujet parait grand sur le capteur (en utilisant le même objectif à sa distance de mise au point minimale). Parallèlement, on assiste aussi à une modification de l’angle de champ qui rétrécit en fonction du coefficient de conversion du capteur. Plusieurs fabricants proposent même des objectifs macro adaptés aux capteurs APS-C. Leur grandissement est alors calculé en tenant compte du coefficient de conversion et la focale et l’angle de champ de l’objectif sont proportionnellement plus petites, permettant une construction à la fois plus petite et plus légère. L’utilisation d’un objectif 24 × 36 sur un capteur APS-H et APS-C n’est pas toujours plus avantageuse : d’une part, la “focale résultante”, plus longue, ne se prête plus forcément aux sujets les plus courants et d’autre part, elle nécessite d’utiliser une vitesse d’obturation plus courte et/ou une sensibilité plus élevée pour compenser le risque de flou de bougé, plus important et rendant l’emploi à main levée de l’objectif plus délicat.

De manière générale, plus la focale d’un objectif est longue, plus la distance de mise au point sera éloignée pour un grossissement donné. Ainsi, pour réaliser des images à rapport 1 : 1, la distance de mise au point est de 24 cm pour un objectif 50 mm, 31 cm pour un objectif 100 mm et 48 cm pour un objectif 180 mm. Sachez qu’il s’agit de la distance entre le sujet et le plan focal, ce dernier étant le plus souvent marquée d’une icône en forme de cercle barré d’un trait horizontal sur la partie supérieure du boîtier. Alors que la distance de travail puisse paraitre encore plutôt confortable pour un objectif de 50 mm et son convertisseur, elle fait en réalité fuir des insectes un tant soit peu farouches et rend l’installation d’éclairages d’appoint plutôt délicate. Bref, mieux vaut travailler avec un objectif d’une focale supérieure ou égale à 100 mm lorsque vos sujets ne sont pas immobilisés sur le plateau d’un statif de reproduction.


L’emploi d’un appareil à capteur APS-H ou APS-C facilite par ailleurs la prise de vue sur le terrain : pour obtenir le même rapport de reproduction, vous pouvez vous éloigner davantage de votre sujet, gage de discrétion pour immortaliser des sujets remuants. Pour photographier des insectes encore plus farouches, et notamment des libellules, vous pouvez adapter des bagues allonges ou une bonnette achromatique sur un téléobjectif plus long. Une focale plus longue aidera non seulement à contrôler l’apparence de votre sujet mais également celle de l’arrière-plan : plus la focale de l’objectif est longue, plus son angle de champ est restreint et plus l’arrière-plan sera réduit à des tonalités et couleurs agréablement diffuses.
Avec un téléobjectif, il est également possible de changer la tonalité de l’arrière-plan via une simple modification de l’angle de prise de vue. Sachez que la profondeur de champ ne change pas avec la focale de l’objectif, pour peu que vous conservez la même taille du sujet et le diaphragme – l’angle de champ est simplement plus restreint, permettant de mieux détacher votre sujet de l’arrière-plan.
Au fur et mesure que la distance de mise point diminue, la profondeur de champ se réduit pour ne mesurer quelques millimètres aux grandissements les plus importants. Ne désespérez pas, ce (prétendu) inconvénient peut même devenir un atout considérable lorsqu’il s’agit de diriger le regard sur les parties les plus intéressantes d’une image et/ou de créer de jolis effets de bokeh.
Alors que certains prétendent le contraire, la profondeur de champ n’est pas directement liée à la taille du capteur (bien que le cercle de diffusion y joue un rôle important…), mais plutôt à la focale de l’objectif utilisé. Toutes proportions gardées, un capteur APS-C procure une profondeur de champ environ une fois et demie plus grande qu’un capteur 24 x 36, la focale de l’objectif employé étant environ 1,5 fois moins longue que celle d’un objectif 24 ×36 doté d’un angle de champ équivalent.
À ouverture et distance de mise au point égales, un appareil à capteur 4/3 et un objectif macro de 50 mm produisent une profondeur de champ deux fois plus importante qu’un appareil à capteur 24 × 36 mm et doté d’un objectif macro 100 mm. En revanche, avec un capteur plus petit, la diffraction compromet plus rapidement le piqué des images : alors qu’il est possible de “visser” le diaphragme à f/16 avec un capteur 24 × 36 sans subir les conséquences néfastes de la diffraction, il faut se contenter d’une ouverture minimale de f/11 (APS-C) ou f/8 (4/3 et Micro 4/3) pour réaliser des images parfaitement nettes. Le choix du diaphragme est alors toujours une affaire de compromis : aux ouvertures les plus grandes, la profondeur de champ est souvent réduite, voire insuffisante, alors qu’aux ouvertures les plus petites, la diffraction réduit la netteté à néant.

Pour maximiser la profondeur de champ, vous pouvez augmenter la sensibilité ISO de votre capteur (attention au bruit) ou réaliser une série d’images avec pour chacune une mise au point légèrement différente (focus stacking). Malheureusement, cette technique ne se prête guère à des sujets vivants et elle demande une grande rigueur à la prise de vue. Avec certains sujets, il suffit d’aligner les parties les plus importantes avec le plan focal. Les objectifs macro ne permettent pas d’obtenir une profondeur de champ plus étendue. Toutefois, leurs performances optiques accrues contribuent à donner cette (fausse) impression : grâce à une excellente correction des différents défauts optiques, les images paraissent plus croustillantes, rendant la transition entre le net et le flou plus franche.